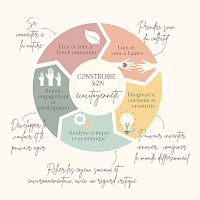Dehors en secondaire, ça le fait !
Dehors en secondaire, ça le fait !
Décembre 2022, par Céline Teret
Un article du magazine Symbioses n°136 : Dehors pour apprendre
Cours dans la cour, école du dehors au square, créations avec la nature au parc, journée en forêt… Tout est bon au Lycée provincial des Sciences et des Technologies de Soignies pour mettre ados et enseignant·es dehors ! Comme quoi, en secondaire aussi, c'est possible.
Face à la gare de Soignies, un square, ses hauts arbres, son vieux kiosque. Des grappes d’ados déambulent en scrutant le sol. L’un d’eux redresse la tête et court vers le kiosque : « Regardez, Madame : érable, gingko et chêne ! » « Super ! Tu as trouvé les trois feuilles, le félicite sa titulaire et professeure de français, Virginie Lago Lago. Tu peux les dessiner dans ton cahier école du dehors et y écrire le nom des arbres. » Il s’assied à côté de ses comparses déjà à l’œuvre. La classe est quasi au complet ce matin, soit une quinzaine d’élèves de 1ère différenciée de l’École du Futur, l’une des trois implantations du Lycée provincial des Sciences et des Technologies de Soignies.
« La nature, ça nous plaît, lance Naomy. Ça nous fait du bien d’être dehors, c’est calme, ça nous aide à réfléchir. » « Oui, on aime bien ces sorties, c’est juste la température…, poursuit Cassandra. Il fait froid là ! » Sa copine Celia, elle, a opté pour un t-shirt à manches courtes et semble s’en accommoder malgré la fraîcheur matinale. « Rappelez-vous, il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que des mauvais vêtements ! », avait lancé leur titulaire, au moment du départ, en montrant une caisse de pulls mise à disposition en classe.
« L’école du dehors, c’est comme pour tout, il y a en a qui vont aimer et d’autres pas, explique Virginie Lago Lago. Mais je constate que cela dépend souvent d’une simple et bête chose : le matériel. Un jeune qui n’est pas équipé, il va souffrir, surtout en hiver. Mais j’ai beau prévenir la veille et avoir une caisse avec du matériel, il y en aura toujours qui n’auront pas l’équipement adéquat. » Les raisons sont multiples : certain·es élèves oublient, d’autres n’ont pas les moyens de se procurer le matériel, d'autres n'ont pas ça sous la main parce que ce n’est pas dans les habitudes de la famille de sortir en nature. Et puis, aussi, enfiler une veste de pluie ou des chaussures de marche, pour un·e ado, c’est loin d’être stylé… « Mais je remarque, poursuit l’enseignante, que si un jeune a froid, bien souvent, la fois suivante, il mettra un pull. Et après quelques sorties, quand les élèves ont vraiment compris le truc, ils s’en fichent complètement de comment ils sont habillés. Au fil du temps, ça finit par rentrer. » D'ailleurs, le matériel nécessaire, tout comme les objectifs et les bienfaits de l’école du dehors, l’enseignante a bien pris le temps de les expliquer en début d’année à ses élèves et aux parents.
Photo : Céline Teret
Marchez, jeunesse !
La sortie matinale se poursuit dans un parc situé non loin. Pour s’y rendre, les élèves sillonnent les rues sonégiennes. Mission sur le trajet : trouver du lierre rampant, de l’armoise commune et du plantain lancéolé. Chaque trouvaille est l’occasion d’échanges et de découvertes. « Faire marcher les élèves, ce n’est pas toujours facile, explique Virginie Lago Lago. Certains jeunes ont l’habitude de marcher en famille, d’autres pas du tout. Ils disent vite qu’ils sont fatigués, mais au final, ils le font. »
Une fois dans le parc, l’une des activités proposées vise à revisiter ensemble les « règles d’or de l’école du dehors ». Il y est question de respect, d’écoute, de dépassement de soi, d’entraide. En tout, les élèves passeront près de deux heures dehors, comme chaque vendredi matin.
Formules variées
Au Lycée provincial des Sciences et des Technologies de Soignies, l’école du dehors figure depuis peu dans le projet d’établissement. L’impulsion est née de Virginie Lago Lago, adepte du dehors et formée au CRIE d’Harchies. « Je me suis dit que ce n’était pas si fou que ça de faire l’école du dehors avec les élèves du secondaire et que certains collègues seraient intéressés par la démarche. Les parents étaient aussi demandeurs. » Il y a deux ans, l’école a été accompagnée par l’asbl GoodPlanet. Tous·tes les enseignant·es ont suivi une formation, de deux jours pour le 1er degré, d’un jour pour les 2e et 3e degrés. « Dans l’ensemble, les professeurs ont bien adhéré. Ils ont compris qu’ils pouvaient soit faire l’école du dehors en créant des activités faisant des ponts entre la nature et leur cours, soit donner leur cours habituel en extérieur, pour prendre l’air et profiter d’un cadre différent. »
Aujourd’hui, chaque professeur·e fait école dehors à sa guise ou… pas du tout. « Ce n’est pas quelque chose qu’on peut imposer, c’est un déclic personnel, il faut y croire », constate l’enseignante. Résultat, les formules varient. Certain·es enseignant·es pratiquent l’école du dehors dans le cadre de leur cours, régulièrement ou occasionnellement. D’autres se réunissent pour organiser ponctuellement une « journée école du dehors », parfois même en forêt et avec l’implication des élèves de la section « animation ». Enfin, le programme « cours à la carte » (2 heures/semaine au choix) propose entre autres les cours « école du dehors » et « créer avec la nature ».
Photo : Céline Teret
Espace dédié
Pour faciliter l’accès au dehors et stimuler davantage encore l’approche pédagogique avec et dans la nature, l’implantation École du Futur accueillera bientôt dans sa cour un espace dédié :
une classe en extérieur, avec une structure en bois pour s’abriter et des troncs pour s’asseoir, ainsi que d’autres aménagements (bacs potager, parcours sensoriel, hôtel à insectes…). En attendant la mise en place de ce nouvel espace, l’école du dehors continue à se pratiquer dans les coins de nature présents dans l’enceinte de l’école ou dans les espaces verts en extérieur : le square, le parc et, plus loin, la forêt.
Après quelques années de pratique, Virginie Lago Lago est convaincue des bienfaits du dehors en secondaire : « J’ai découvert d’une autre façon des jeunes très éteints en classe. Sortir permet aux élèves qui ne sont pas scolaires de trouver une motivation et de s’épanouir. Ça crée des liens, que je n’arrive pas à créer en classe. Dehors, les élèves se retrouvent aussi devant des choix, alors qu'habituellement, l’école ne leur laisse pas le choix, ils suivent leur horaire, on leur dit de faire ci, de faire ça... Dehors, c’est très différent, ils devront choisir un arbre, un chemin… Et moi, personnellement, je n’ai plus l’impression d’être une prof, je suis une personne qui aime être dehors et qui partage ce qu’elle sait.
Quand je ne sais pas, je le dis et on cherche ensemble. Ça rééquilibre les rapports entre nous. Et si parfois certains élèves n’aiment pas, ce n’est pas grave, au final, on les aura quand même fait sortir ! »
Photo : Céline Teret
Pourquoi ça bloque ?
« Un gros frein pour faire école du dehors en secondaire, ce sont les horaires, lance Isabelle Vermeir de l’asbl Tournesol.
50 minutes de cours, c’est peu, surtout si l’espace vert n’est pas à proximité immédiate de l’école. Pour lever ce frein, les enseignants peuvent travailler ensemble pour rassembler des heures. Encore faut-il que ça se mette bien au niveau des horaires. Cela demande donc une organisation pour des enseignants qui sont déjà à flux tendu. »
Pour Muriel De Borman, professeure de philosophie et citoyenneté au Lycée Intégral Roger Lallemand (LIRL) à Saint-Gilles, l’horaire minuté est de fait un frein, tout comme l’encadrement : « Avec une classe de 27 élèves, il faut plusieurs accompagnants pour sortir. Au LIRL, on fonctionne par projets organisés en modules de 3 semaines, donc on travaille souvent en équipe, ce qui résout une partie du problème. Globalement, les écoles manquent de moyens humains pour mieux accompagner les élèves lors de ces sorties, d’autant que les éducateurs sont surchargés. »
L’enseignante évoque aussi la charge administrative des écoles, en ce compris la question de l’assurance.
Alex Liesenborghs est professeur de sciences à l’Athénée Royal Bruxelles II. Là-bas, le dehors est à portée de main : la cour de récréation dispose d’un potager et d’une « zone détente » avec des bancs pour donner cours en extérieur.
Encore amenés à se développer grâce à l’Opération Récréation, ces recoins de nature intramuros lèvent le frein des autorisations de sortie et autres paperasseries. L’enseignant relève cependant une autre difficulté : « Les manuels scolaires, auxquels se raccrochent beaucoup d’enseignants pour coller au programme, ne sont pas adaptés à une activité extérieure. Il faut donc retravailler son cours en ce sens et oser sortir du manuel. Chez nous, sur les 80 profs, une douzaine donnent cours dehors, de sciences, philo, français, géographie, néerlandais… de façon plus ou moins régulière. Le dehors, ça a un effet apaisant sur nos jeunes, ils n’ont plus de murs, plus de plafond. Ils expérimentent et vivent les apprentissages dans leur chair. Ils se mettent en projet et y voient la finalité. »
« Ce sont aussi des jeunes qui sortent peu de leur quartier, constate pour sa part Muriel De Borman. Ils traversent peutêtre le parc, mais ne savent pas ce que c’est d’y rester. La nature peut avoir un côté impressionnant pour eux. Tout cela se prépare. Par ailleurs, les ados n’aiment pas s’habiller autrement et ils ont besoin que leurs habits restent propres.
Le confort est essentiel et implique du matériel : des mousses pour s’asseoir, une bâche, une tonnelle en cas de pluie... Et un local pour stocker tout ça. »
Autre indispensable pour les deux enseignant·es, comme pour l’animatrice : des directions soutenantes. Isabelle Vermeir invite à s’interroger pour que « l’école du dehors soit intrinsèquement liée au fonctionnement de l’école et que la direction accorde du temps à l’équipe enseignante pour s’y consacrer pleinement, pour que ça n’apparaisse pas comme ‘‘un truc en plus’’ pour des équipes déjà surchargées. »