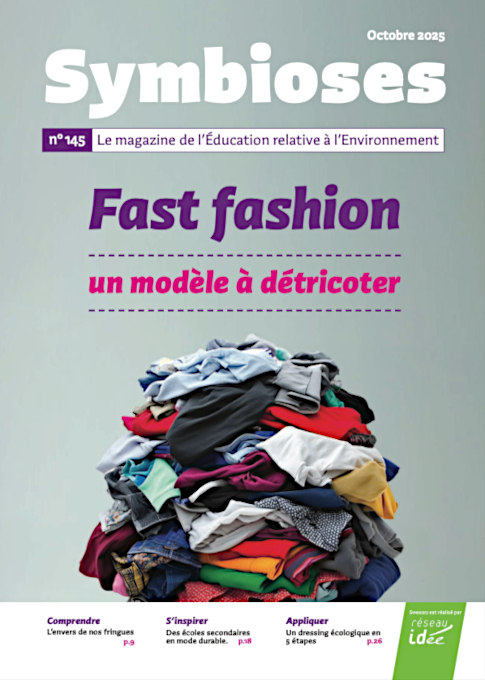La seconde main à la croisée des chemins
La seconde main à la croisée des chemins
Octobre 2025, propos recueillis par Sophie Lebrun
Un article du magazine Symbioses n°145 : Fast fashion : un modèle à détricoter
La fripe, c’est chic ? De fait, la seconde main prend du galon dans nos habitudes de consommation. Toutefois, l’afflux démesuré de vêtements mis au rebut, ses causes (fast fashion, surconsommation…) et ses conséquences sur les acteurs de l’économie sociale et circulaire, ont de quoi interpeller. Entretien avec Franck Kerckhof, directeur adjoint de la fédération Ressources.
Photo ©Sophie Lebrun
Le vêtement de seconde main a le vent en poupe. Une bonne nouvelle, en soi, son empreinte environnementale étant moindre que celle du neuf. Avec des nuances, toutefois, selon la filière empruntée (en direct de particulier à particulier, en magasin, via une plateforme de type Vinted…). Des filières qui se distinguent aussi par leur finalité : profit ou solidarité.
Franck Kerckhof est le directeur adjoint de Ressources, la fédération des entreprises d'économie sociale et circulaire actives dans le réemploi des biens et des matières (en Wallonie et à Bruxelles). 25 des 79 membres de Ressources ont une activité dans le domaine textile : collecte (via les bulles à vêtements ou le dépôt en magasin), tri, revente, transformation (voir encadré). Dont trois acteurs historiques de la seconde main en Belgique : Terre (lire aussi Dans l’antre du tri), Les Petits Riens et Oxfam Belgique. La filière textile constitue « près de 50% de l’activité de notre secteur, souligne Franck Kerckhof. Or, elle traverse actuellement une crise multifactorielle ». Explications.
Peut-on dire que l’achat de vêtements en seconde main – dans toutes ses filières – est en expansion ?
En effet, il enregistre une forte croissance depuis dix ans. Ce marché commence à concurrencer le commerce de première main – ce qui explique que de gros groupes textiles s’attaquent à ce segment de produits, par exemple en organisant un « coin seconde main » dans leurs magasins. Une étude française indique qu’aujourd’hui, 50% des consommateurs se disent prêts à acheter des vêtements déjà portés (1), et toutes les catégories sociales sont concernées, alors qu’il y a dix ans encore, beaucoup pensaient que c’était réservé aux « pauvres ». Cela devient un modèle de consommation important. D’autant que le secteur se professionnalise et offre finalement une expérience client assez équivalente au neuf. Avec cependant des « plus » sociaux, environnementaux et économiques, dans le cas des entreprises d’économie sociale et circulaire.
Pourriez-vous préciser ces spécificités ?
Ces acteurs de l‘économie sociale et circulaire créent des emplois non délocalisables, avec une attention pour les personnes éloignées du marché du travail (insertion socio-professionnelle). Et les bénéfices dégagés servent à financer, d’une part, des actions sociales au niveau local (de l’hébergement pour sans-abri, des cantines et des épiceries sociales, une aide aux femmes isolées…) et, d’autre part, des projets de solidarité et de développement dans des pays du Sud (accès à l’eau, agroécologie, etc.). Nos membres travaillent en circuit court, par ailleurs, en revendant dans leur réseau de boutiques les objets collectés. Lesquels sont issus de dons, autre spécificité.
En quoi cette filière est-elle aujourd’hui bouleversée ? On voit, notamment, que les bulles de collecte de Terre, des Petits Riens et d’Oxfam débordent…
En 2025, on projette que 35 000 tonnes de textiles (ce qu’on appelle les TLC : textiles, linge de maison et chaussures) seront collectées, en Wallonie et à Bruxelles, par notre réseau. Soit une augmentation de 10% par rapport à 2024, année où l’on avait déjà enregistré une hausse de 12,7% ! Le citoyen belge se sépare en moyenne de 16 kilos de textiles par an : deux fois plus qu’il y a dix ans. Cette croissance exponentielle nécessite davantage d’infrastructures et de capacités de gestion de flux. De plus, l’offre étant bien plus importante que la demande, et la qualité étant moindre, la possibilité de valorisation de ces textiles diminue. Les entreprises d’économie sociale impliquées sont donc débordées et fragilisées, comme elles l’ont d’ailleurs rappelé en juillet aux gouvernements régionaux (2).
Comment expliquer ce surplus ?
S’il y a trop de vêtements de seconde main sur le marché, c’est en grande partie parce qu’il y a beaucoup trop de vêtements neufs mis sur le marché – et achetés –, un véritable tsunami (lire L’envers de nos fringues). Les acteurs qui inondent le marché de produits neufs à bas prix (en particulier Shein et Temu, mais aussi des enseignes européennes : Primark, Kiabi, Inditex/Zara, H&M…) ne sont pas assez responsabilisés, en termes d’éco-conception et de prise en charge de la fin de vie du vêtement (reprise, recyclage, incinération). Alors que la chaîne textile est l’une des plus polluantes au monde ! Cette « Responsabilité élargie du producteur » (REP), prévue par l’UE, qui prévaut déjà pour d’autres filières (cf. la taxe Recupel sur les appareils électr(on)iques), devra toutefois être appliquée au plus tard en 2028.
En attendant, notre filière doit traiter d’énormes quantités de textiles, notamment incinérer d’énormes quantités de déchets textiles. D’autant plus que, depuis janvier 2025, le citoyen ne peut plus jeter ses textiles usagés à la poubelle, mais doit les placer dans les bulles (3).
Ce qui a aussi chamboulé le marché de la fripe, ce sont les plateformes de vente et d’achat en ligne de consommateur à consommateur, Vinted en tête…
Des plateformes qui ont été boostées par le confinement Covid. Vinted génère aujourd’hui un énorme trafic de vêtements de seconde main. Conséquence, là encore : notre secteur collecte proportionnellement moins de vêtements de très bonne qualité et en très bon état (ce qu’on appelle « la crème » dans nos filières de tri), dès lors qu’une partie de ceux-ci est vendue via ces plateformes (4). Or, la revente de ces vêtements via les boutiques de notre réseau – et désormais via notre plateforme larecup.be – est un maillon essentiel du modèle économique de nos entreprises.
Une autre « concurrence » vient de fripiers industriels. Comme notre secteur, ils collectent et exportent vers l’étranger. Mais certains ne procèdent pas à un tri préalable, et sont en partie responsables des montagnes de déchets textiles qui polluent notamment les plages d’Afrique. Résultat : certains pays concernés – par ailleurs de plus en plus inondés de vêtements neufs de la fast fashion – restreignent l’importation de seconde main.
D'autres facteurs impactent nos entreprises, notamment la récession de l’industrie européenne, qui implique une réduction de la demande de textiles recyclés (chiffons d’essuyage, produits de rembourrage…) ; et l’explosion du coût du travail et de l’énergie.
Le secteur se montre toutefois créatif : Les Petits Riens et Terre créent et vendent des vêtements upcyclés (5).
L’upcycling est une activité, encore modeste et artisanale, que l’on envisage de développer à plus grande échelle à l’avenir. Mais cela demande des moyens – peut-être que la REP pourra y aider. C’est un segment innovant. On crée là des pièces originales et éco-responsables. C’est une autre forme de réutilisation.
Rappelons que le recyclage de la fibre elle-même (coton, laine…) pour créer d’autres textiles, ce qu’on appelle le fibre à fibre, est un processus complexe et encore marginal (0,3% de la production actuelle).
Raison de plus pour agir en amont, au niveau de la prévention.
C’est évidemment le premier réflexe que le citoyen doit avoir. Acheter moins. Porter plus longtemps ses vêtements. Et ensuite éviter la fast et l’ultra fast fashion autant que possible, en achetant le plus qualitatif, local, circulaire et solidaire possible.
La filière du réemploi textile de l’économie sociale et circulaire wallonne et bruxelloise, c’est :
- 500 emplois
- 31 600 tonnes de textiles collectés et triés en 2024. 7,5% sont vendus localement (boutiques de seconde main du réseau d’économie sociale) ; 42% sont exportés (en Europe et surtout hors Europe) ; 30,5 % (qui ne sont plus en état d’être portés) sont downcyclés en chiffons d’essuyage, rembourrage pour l’industrie automobile, etc. ; et 20% sont incinérés avec valorisation énergétique.
- 200 boutiques d’objets (notamment vêtements) de seconde main.
(1) Comportements d’achat, Black et Green Friday, étude co-financée par le Collectif Green Friday et la MAIF, 2022.
(2) A la suite de quoi le Gouvernement wallon a, le 17 juillet 2025, décidé d’octroyer des moyens supplémentaires aux entreprises concernées.
(3) Textiles troués et abîmés compris, à condition d’être propres et secs.
(4) Face au slogan de Vinted « Tu ne le portes pas ? Vends-le », l’association française Emmaüs avait d’ailleurs contre-attaqué avec la campagne « Tu ne le portes pas ? Donne-le ! »
(5) Vendus dans leurs magasins sous les marques Label Jaune et RE-VIVE. Un vêtement upcyclé est un vêtement customisé ou créé à partir de textiles abîmés. Par ex. un short issu d’un pantalon, un T-shirt rebrodé, mais aussi un vêtement créé en assemblant différentes pièces.