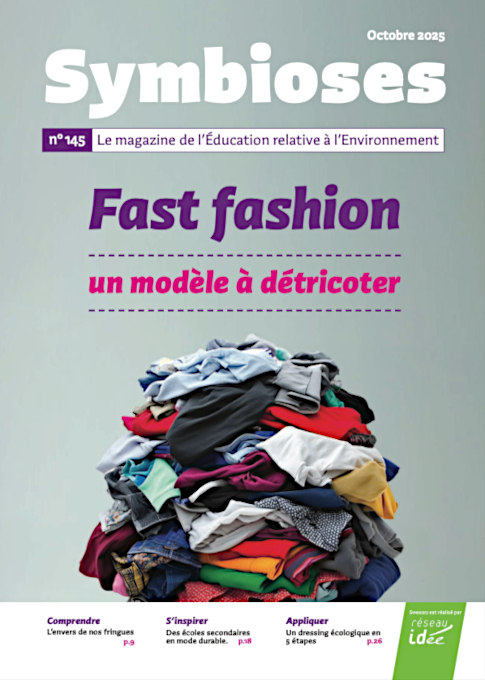L’envers de nos fringues
L’envers de nos fringues
Octobre 2025, un article de Christophe Dubois
Un article du magazine Symbioses n°145 : Fast fashion : un modèle à détricoter
L'industrie textile carbure à la surproduction. Des prix cassés, des collections toujours plus rapides, des placards toujours plus remplis. Mais quel est le prix humain et environnemental de cette fast fashion ?
Photo : ©Will Baxtern, Labour Behind the Label
Aujourd’hui, c’est décidé, c’est journée « tri des vêtements » chez les Dupont. Les garde-robes débordent, gavées de fringues entassées au fil des ans. Des pièces que les membres de la famille n’ont pour la plupart plus mises depuis longtemps. Jeans désormais jugés trop slim, chemise pas « comme il faut », t-shirt au motif dépassé… Sans parler des habits abîmés. Selon les chiffres français de l’ADEME et de l’Observatoire Société & Consommation, nous aurions en moyenne 175 vêtements dans nos placards et en portons moins de la moitié. D’ailleurs, nous pensons n’en avoir que la moitié.
Chez les Dupont, la stratégie de tri est bien rodée : « Un tas pour ce qu’on garde, un autre pour ce qu’on veut vendre, un troisième pour ce qu’on donne aux Petits Riens ; et un dernier avec ce qu’on jette car c’est abimé », lance le père. Comme la plupart des Belges, ils et elles ne feront pas de tas avec les vêtements à réparer ou transformer. Ils possèdent une machine à coudre héritée de la grand-mère, mais ne savent pas s’en servir. Après le tri, laborieux, l’ado revendra les vêtements les plus tendance sur Vinted. De quoi s’acheter de nouveaux vêtements.
Et qu’adviendra-t-il des habits déposés dans la bulle de collecte ? D’abord, ils seront à nouveau triés. Chez nous, la filière du recyclage et du réemploi textile croule sous les tonnes de vêtements, dont 60% sont collectés et triés par des associations telles Oxfam, Terre et Les Petits Riens. Cet été, elles ont alerté les gouvernements régionaux, dépassées par l’afflux de (déchets) textile (lire La seconde main à la croisée des chemins). Une fois triés, seuls 7,5% seront revendus via un réseau de boutiques de seconde main en Belgique. Le reste sera exporté à l’étranger (42%), recyclé (30,5%) ou incinérés (20%) (1).
Le voyage de nos fripes
L’anthropologue française Emmanuelle Durand a retissé le parcours des vêtements usagés ou invendus, avant qu’ils ne soient définitivement considérés comme des déchets. Elle raconte ce voyage dans L’envers de fripes (2). Issam, entrepreneur actif dans l’exportation de fripes, lui explique le fonctionnement de son entrepôt de tri, à Bruxelles. Il achète les vêtements à la tonne, à un prix variant selon le quartier où est située la bulle de tri (ce qui est collecté dans un quartier riche est plus cher) : « Ici, le trieur classe les vêtements dans différents tas en fonction de différents critères (marque, matière, coupe, état). En général, la crème reste en Europe [de l’Est]. Les clients d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient, ils achètent plutôt la deuxième catégorie. La troisième part sur les marchés africains, et les chiffons en Asie ». Puis d’avouer qu’il songe à délocaliser le tri à Dubaï, où la main-d'œuvre est bien moins chère qu’en Belgique.
En effet, de l’autre côté de la planète, d’autres trient encore. A Dubaï, mais aussi au Ghana. Comme les vendeurs et vendeuses du marché de seconde main de Kantamanto, à Accra, l’un des plus grands marchés de vêtements de seconde main au monde. Des milliers de mains y déplient, lavent, réparent chaque semaine 1000 tonnes de vêtements usagés, empaquetés dans d’énormes ballots en plastique importés d’Europe et d’ailleurs ; comme ceux d’Issam. Hélas, suite à l’expansion de la fast fashion et à la diminution de la qualité des vêtements, beaucoup sont invendables et atterrissent dans des décharges sauvages et toxiques, jusqu’aux plages et zones protégées africaines. Les tissus colorés et déchirés s’y amoncellent ou s’y enfouissent dangereusement. Une réalité que l’on retrouve aussi dans le désert chilien d’Atacama, et en tant d’autres territoires du Sud global.
Un gaspillage cousu de fil blanc
Comme les Dupont, nous sommes nombreux·ses à posséder trop de fringues. Selon le baromètre de la consommation textile en France, chaque Français·e a acheté en moyenne 42 vêtements et 4 paires de chaussures neufs en 2024. Les chiffres pour la Belgique devraient s’en approcher. On consomme littéralement presque autant d’habits que les Italiens des paquets de pâtes. Nous sommes collectivement boulimiques de vêtements. Entre 2000 et 2020, la production mondiale de textile a doublé, pour atteindre 150 milliards de pièces par an (3) – dont 20 à 30% resteront invendus. En cause ? Notamment les multinationales de la fast fashion qui – par une surproduction volontaire, des prix dérisoires, des modèles constamment renouvelés, une publicité massive et ciblée, des ristournes permanentes – nous incitent à trop consommer. La plupart des grandes enseignes et marques de vêtements que l’on retrouve dans les rues commerçantes et magasins virtuels participent peu ou prou à ce modèle de mode éphémère, aux impacts sociaux et environnementaux colossaux. Les plus connues : H&M, Primark, Kiabi, Boohoo, Zara, Shein…
« Mais en réalité, la surproduction et les mauvaises conditions de travail concernent la quasi totalité de l’industrie du vêtement », souligne Zoé Dubois, chargée de plaidoyer pour l’association achACT, visant à améliorer les conditions de travail de celles et ceux qui fabriquent nos vêtements. « La version textile de l’obsolescence programmée s’appelle la mode, écrit Catherine Dauriac (3), présidente du mouvement Fashion Revolution France. Le prêt-à-porter est devenu prêt-à-jeter ».
Finies les deux collections annuelles, calquées sur les saisons (printemps-été puis automne-hiver). Zara sort 24 collections par an, 500 modèles par semaine. Le message de la marque, pionnière de la mode éphémère : dépêchez-vous de consommer. Depuis quelques années, la cadence s’est encore accélérée, avec l’arrivée de l’ultra fast fashion de Shein et ses 6000 nouveaux designs hebdomadaires à prix cassés (4). La jolie robe de soirée y coûte à peine 7€, le costume homme complet 30 €. Le modèle économique de l’entreprise chinoise s’appuie sur une chaîne logistique hyper-flexible, permettant des délais de quelques jours entre conception, vente en ligne et distribution (souvent par avion), avec un renouvellement permanent générant plus d’un tiers d’invendus. Le tout boosté par de puissants algorithmes qui analysent et alimentent les envies de ses cibles sous toutes leurs coutures (5).
Sous-traitances en cascade
« Si on devait résumer en un mot le modèle économique et productif de la fast fashion, ce serait “sous-traitance”, explique Zoé Dubois. Toutes ces marques sous-traitent le travail de confection à des entreprises tierces, à des usines qui ne leur appartiennent pas. » Cela fonctionne par contrat d’achat temporaire : la marque a besoin de tels vêtements en telle quantité, dans tel délai imparti. « Les usines sont mises en concurrence pour offrir les prix les plus bas. Et pour offrir des coûts bas, la principale variable d'ajustement, ce sont les conditions de travail. Comme on leur demande de produire énormément en peu de temps, ces usines vont elles-mêmes sous-traiter une partie du travail à d'autres ateliers, parfois plus petits, plus informels, qui respectent encore moins le droit du travail. Jusqu'au travail à domicile, y compris par des enfants. »
Les pays producteurs – Chine (41% du marché mondial), Bangladesh, Inde, Vietnam, et dans une moindre mesure la Turquie, les pays de l’Europe de l’Est… – sont également mis en concurrence pour maintenir des normes sociales et environnementales faibles. En coulisses, les multinationales textiles tirent les ficelles.
Des vies suspendues à un fil
Mais quelles sont les conditions de travail de l’ouvrière – ce sont très majoritairement des femmes – qui se cache derrière l’étiquette du t-shirt à 5 euros ? Horaires à rallonge (12h par jour en moyenne, 6 jours par semaine), salaire en dessous du minimum vital, absence de syndicat, harcèlement moral ou sexuel, exposition à des produits chimiques néfastes, bâtiments dangereux (on se souvient de l’effondrement du Rana Plaza) (6), gestes répétitifs douloureux… « Les travailleuses touchent généralement moins de la moitié du salaire minimum vital du pays. A ne pas confondre avec le salaire minimum légal, auquel se réfèrent les entreprises, mais qui, dans de nombreux pays, est très insuffisant pour subvenir aux besoins vitaux, précise Zoé Dubois. Le salaire minimum vital, c’est l’étalon d’achACT. Il permet de subvenir à ses besoins fondamentaux et ceux de sa famille. On en est très loin, avec des proportions différentes en fonction des pays, des régions ou des usines. Mais on n’a pas une vue précise par usine : les marques sont généralement très opaques concernant les conditions de fabrication de leurs vêtements. On sait juste dans quel pays c’est produit. » A cet égard, le Made in Europe de l’Est ne garantit absolument pas un salaire suffisant. Les travailleuses de la confection y touchent en moyenne moins de 30% du salaire minimum vital (7). Un prix de vente du vêtement plus élevé n’assure pas non plus de meilleures normes sociales et environnementales, mais relève davantage d’une stratégie marketing. L’habit ne fait pas le moine.
A cela s’ajoute, parfois, le travail forcé. « Si les Etats-Unis ne contraignent plus des hommes à ramasser des fleurs de coton, il n’en est pas de même pour l'Ouzbékistan, désormais boycotté par 300 marques », explique Emilie Pouillot-Ferrand dans son ouvrage Textiles éthiques (voir S’outiller p.30). Citons encore les centaines de milliers de Ouïghours, minorité turcophone musulmane déportée par la Chine vers la région du Xinjiang pour y assurer de force la culture et la transformation du coton, lequel alimenterait plus de 40 marques occidentales. « Au-delà du cas emblématique des Ouïghours, ne peut-on pas aussi parler de travail forcé lorsque des personnes, de par leur précarité, sont condamnées à accepter des conditions de travail indignes, dangereuses, exténuantes, voire souvent illégales ? », interroge enfin Zoé Dubois.
L’environnement victime de la mode
« Les travailleurs et travailleuses, notamment au Pakistan ou au Bangladesh, nous parlent également de plus en plus des effets des changements climatiques sur leurs conditions de travail, avec des chaleurs intenables, ou des risques d'inondation qui peuvent mettre les productions à l’arrêt », explique l’experte d’achACT.
Un dérèglement climatique lui-même accéléré par l’industrie de l’habillement. Celle-ci serait responsable de 4% à 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, principalement pour obtenir la matière première et la transformer en vêtement fini. En réalité, chaque étape de la vie d’un vêtement pollue (l’eau, les sols ou l’air) et consomme des ressources (énergie, eau, matières premières, produits chimiques) : de l’extraction de la matière première à l’enfouissement ou l’incinération, en passant par la filature, la confection, l’ennoblissement (teinture, délavage des jeans, blanchiment, apprêts pour faciliter l’entretien), la distribution, le lavage... Selon l’ADEME (8), la consommation de textiles représente la 4e source d’impact sur l’environnement et le changement climatique de l’Union européenne, après l’alimentation, le logement et les transports.
Quelques chiffres : au niveau mondial, le secteur textile est le 3e plus gros consommateur d’eau (9). Cela pour produire la matière première (notamment le coton, très gourmand), pour la teinture, le blanchiment du tissu, le lavage… Une eau que ce secteur pollue énormément. Par les produits chimiques utilisés pour produire les fibres, pour les teintures et autres finitions, et qui finissent dans la rivière locale. Mais aussi par le lavage des vêtements en fibres synthétiques : chaque année, 500 000 tonnes de microparticules de plastiques non biodégradables se retrouvent ainsi dans les océans, soit l’équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique (3). Sans parler des déchets générés par la surproduction, déjà évoqués plus haut. Chaque Belge se défait de près de 14 kg de vêtements par an. Par ailleurs, saviez-vous que 20% des vêtements achetés en ligne sont renvoyés par le consommateur ? Et qu’un tiers de ces retours finissent par être détruits (10) ! Pour la marque, cela revient moins cher que de les remettre sur le marché...
Des risques pour la santé
« Tous les segments de la confection d'un vêtement sont extrêmement polluants. Outre la pollution de l’eau dans l'environnement direct des usines, cette industrie utilise des produits ultra toxiques pour la santé des travailleurs et des consommateurs, explique encore Zoé Dubois. Par exemple, le permanganate de potassium pour vieillir artificiellement les jeans ou des antifongiques et des anti-moisissures pour éviter que les vêtements ne s'abîment durant leur voyage sur des milliers de kilomètres. C'est pour ça aussi qu'il faut laver ses vêtements neufs au retour du magasin. » (11)
Testachats a d’ailleurs mesuré les substances toxiques présentes dans les vêtements pour enfants de la marque Shein. Résultats ? Au moins une substance dangereuse a été trouvée dans 10 des 25 articles analysés : « Des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens, des allergènes tels que le nickel, mais aussi des irritants, comme le diméthylformamide, la quinoléine, en plus d’éthoxylates de nonylphénol. Ces derniers sont surtout nocifs pour les organismes aquatiques, mais avec letemps, ils se décomposent en une autre substance, perturbatrice du système endocrinien », note l’association de protection des consommateurs (12), qui en appelle à une meilleure régulation et de meilleurs contrôles.
Quelles solutions ?
En matière de régulation, depuis la publication en 2022 de la Stratégie de l’Union Européenne pour des textiles durables et circulaires, plusieurs initiatives et directives européennes ont touché la filière textile : en matière de greenwashing, d’éco-conception, de réduction et de traitement des déchets, de devoir de vigilance des entreprises (afin d’identifier les risques pour les droits humains et l'environnement dans leurs chaînes de production et y remédier)… A cela s’ajoutent les travaux de l’OCDE et des Nations Unies. Hélas, la route est encore longue avant que ces orientations ne soient suffisantes et appliquées à tout le secteur, ici et jusqu’au fin fond d’un atelier d’Asie du Sud-Est. D’autant qu’aujourd’hui, ces avancées sont remises en question par un recul politique sur les enjeux environnementaux.
Mais alors que faire ? Chacun peut, à son échelle, consommer moins et mieux (lire notamment Un dressing écologique en 5 étapes). Sensibiliser autour de soi, à l’image des initiatives présentées dans ce Symbioses. Mais aussi soutenir des collectifs qui sensibilisent aux impacts de la fast fashion, font pression sur les législateurs et sur les marques, afin qu’elles produisent moins, de façon plus respectueuse de l’environnement, des travailleurs et des travailleuses. « On est à une époque où on individualise beaucoup les enjeux, donc on se demande toujours comment agir à l'échelle individuelle. C’est important, mais je crois qu’en prenant part aussi à des actions plus collectives, comme celles que nous proposons chez achACT, via des pétitions, des actions de sensibilisation, des actions directes, on peut avoir un impact potentiellement plus important, estime Zoé Dubois. Les marques bougent quand elles se rendent compte qu'on fait attention à ce qu'elles font ». Avec parfois de belles victoires : depuis l'effondrement du Rana Plaza, un accord contraignant s’est mis en place au Bangladesh, et maintenant aussi au Pakistan, spécifique aux enjeux de santé et sécurité dans les usines. C’est une victoire importante du réseau Clean Clothes Campaign. « La mobilisation citoyenne a vraiment changé les choses sur le terrain », se réjouit la chargée de plaidoyer. Dans les plis de la mode éphémère, la résistance s’organise, les alternatives émergent. En mode slow : lentement, mais sûrement.
Sources
(1) Textiles, 80% des textiles sont valorisables mais…, RESSOURCES, Fédération des entreprises sociales et circulaires.
(2) L’envers des Frippes, éd. Premier Parallèle, 2024 (voir S’outiller p.30).
(3) Fashion, Fake or not, C. Dauriac, éd. Tana, p.36, 2022 (voir S’outiller p.30).
(4) Shein, chronique d’un géant de l’ultra fast fashion 2.0, achACT, 2024.
(5) Shein, la marque de l’ultra fast fashion qui envahit le monde, Bon Pote, 2023.
(6) Le Rana Plaza abritait plusieurs ateliers de confection de vêtements travaillant pour diverses marques internationales, à Dacca (Bangladesh). En 2013, il s’est effondré, causant 1135 morts. Les ouvrier·es avaient été contraint·es de venir travailler ce jour-là, malgré des fissures détectées la veille.
(7) Made in Europe, au delà des apparences : salaire vital où es-tu ?, achAct.
(8) Tout comprendre - Les impacts de la mode et de la fast-fashion, ADEME, 2025. (voir S’outiller p.30)
(9) Analyse des pratiques liées aux achats de produits d'habillement... et leurs impacts environnementaux, ADEME, 2025.
(10) The destruction of returned and unsold textiles in Europe’s circular economy, Agence européenne de l’environnement, 2024.
(11) La toxicité de nos vêtements, achACT, 2024.
(12) Testachats découvre des substances nocives dans 10 des 25 articles pour enfants achetés sur Shein, TestAchats, 2024.
(13) Production et déchets textiles : les impacts sur l’environnement (infographies), Parlement européen, 2020.
2/3 de nos fringues contiennent du pétrole
Jusqu’au XIXe siècle, les vêtements étaient fabriqués uniquement avec des fibres naturelles issues de plantes (lin, coton, chanvre, ortie) ou d’animaux (laine, cuir, soie). Puis, l’arrivée du pétrole a marqué une révolution en permettant de créer des fibres chimiques, classées en deux grandes familles :
- Les fibres artificielles, comme le lyocell ou la viscose, issues de matières naturelles telle que la cellulose, mais modifiées par des procédés chimiques polluants.
- Les fibres synthétiques (nylon, polyester, acrylique, Lycra, élasthanne…), obtenues directement à partir de dérivés du pétrole chauffés et transformés en filaments. A elles seules, elles représenteraient 65 % de la production mondiale de textile.
Dorénavant, on s’habille surtout de pétrole. Donc, si on veut décarboner, il va falloir apprendre à consommer moins de vêtements.
Remontons le fil de la fabrication de textile
Jusqu’au XVIIe siècle, le vêtement était un produit rare, tissé et cousu à la main. La majorité de la population n’en possédait que quelques pièces, qu’on se transmettait de génération en génération, au fil des rapiéçages. Avec la révolution industrielle et l’essor du capitalisme, sont apparues la mécanisation et les premières manufactures permettant de produire en série, alimentées par le coton produit aux Etats-Unis par les esclaves noirs, puis par l’Inde coloniale, notamment.
Ensuite, c’est l’essor du prêt-à-porter et des fibres synthétiques, à partir des années 1960, qui fait progressivement disparaître les couturières de quartier. Dans les années 1990, l’arrivée de la fast fashion accélère le mouvement.
Dis moi ce que tu mets, je te dirai ce que tu es
Au-delà de l’influence de la publicité et des stratégies commerciales, quelles sont les explications sociologiques et psychologiques de nos choix et comportements vestimentaires ? « La mode est une tension entre distinction et imitation », résume le sociologue Frédéric Godart*. On s’habille à la fois pour s’affirmer soi et pour être accepté·e par les autres. C’est particulièrement vrai à l’adolescence, moment où l’individu est le plus sensible aux aspects symboliques de sa consommation vestimentaire.
En choisissant tels vêtements, nous disons : « je fais partie de tel groupe et pas de tel autre ». Le costume pour le dirigeant, la marque de luxe comme signe extérieur de richesse, le look éth(n)ique-seconde main pour traduire son attention pour la planète… Opter pour tel style, c’est aussi se situer dans les hiérarchies culturelles et sociales, nous dit Bourdieu. Porter une veste de créateur ou un survêtement n’envoie pas le même signal : ce sont des marqueurs sociaux.
A l’inverse de cette recherche de conformisme et d’appartenance, s’habiller de façon moins conventionnelle permet de se démarquer, d’affirmer sa singularité, ses valeurs, ses goûts, son humeur. Ainsi, le style vestimentaire peut être un moyen de renforcer l’estime de soi, de marquer son identité, mais il peut aussi être une source d’inquiétude et d’exclusion pour celles et ceux qui ne seraient ou ne se sentiraient « pas dans le coup ». C.D.
*F. Godart, Sociologie de la mode, La Découverte, 2016/