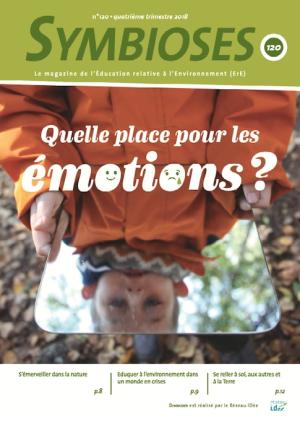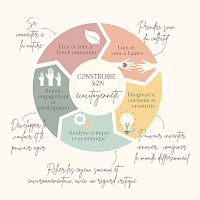Un stage d’abandon nocturne
Un stage d’abandon nocturne
4è trimestre 2018, propos recueillis par Christophe Dubois
Un article du magazine Symbioses n°120 : Quelle place pour les émotions ?
Passer une nuit, seul·e, en forêt. Pour libérer nos émotions inconscientes. Puis ausculter nos peurs, à l’origine de notre besoin de maitrise - voire de destruction - de la nature. Interview de Jean-Claude Génot, qui propose ce type d’expérience, en association avec CESAME.
photo ©JC Génot
Vous organisez des stages d’abandon nocturne. En quoi cela consiste-t-il ?
Les gens sont déposés de nuit, suffisamment loin les uns des autres dans des vallées adjacentes, dans une forêt qu’ils ne connaissent pas, au sein du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Les consignes sont de ne pas prendre de lampe, de tente ou de portable. Pour le reste, les participants peuvent s’équiper chaudement (duvet, tapis de sol, couverture de survie, vêtements chauds et imperméables), le but n’étant pas de faire un stage de survie. C’est le point de départ. Le lendemain, nous nous retrouvons et nous décortiquons notre expérience durant deux jours.
D’où vous est venue cette idée ?
Je ne fais que reproduire ce qui avait été mis au point par François Terrasson, penseur radical de la nature auquel j’ai consacré un ouvrage (1). S’il faut retenir une idée centrale dans le foisonnement de sa pensée, c’est bien le fait que l’homme détruit la nature parce qu’il en a peur. Dormir seul·e la nuit en forêt permet justement de tester notre peur éventuelle de la nature. C’est une véritable expérience du sauvage. Notre nature maîtrisée paraît de plus en plus domestiquée, sans surprise. Mais ce qui fait son caractère sauvage et effrayant, c’est la forêt, la nuit, la solitude et la désorientation. On met les gens en condition d’être face à eux-mêmes. La nature va servir de miroir. De façon imprévisible, elle va leur renvoyer des choses qui sont enfouies au plus profond d’eux-mêmes, dans leur inconscient. Comme le soulignait Terrasson : « Le mouvement naturel d’un être humain isolé dans la nature, sans aucun repère de civilisation - et d’autant plus la nuit - est de fantasmer à mort, dans un délire né de rien, sinon de rêves vagues, de chimères et de ces mythes, ces légendes multiples qui sous-tendent notre culture ». Bref notre cerveau travaille et déverse à notre insu des informations continues que l’on ne soupçonnait peut-être pas. Toutes les gammes de comportements et d’émotions peuvent se révéler. On ouvre une boîte de Pandore.
Après cette nuit, vous débriefez avec les participant·e·s, vous sondez les émotions ressenties…
Oui, chaque personne va raconter durant une heure la période qui a précédé la nuit et le déroulement de la nuit, mettre des mots sur ses impressions, ses sensations et ses pensées. Ensuite, elle va partir des émotions vécues pour questionner son rapport à la nature et au sauvage. C’est facile de dire que l’on aime la nature, mais ce type d’expérience peut révéler des émotions jusque là insoupçonnées, même chez des animateurs nature. Ce travail d’accompagnement ne s’improvise pas. Cette partie-là, essentielle, est assurée par Stefan Alzaris, enseignant-chercheur à l’université Paris-Sud 11, philosophe, thérapeute et guide nature. Stefan anime l’association CESAME qui allie la philosophie existentielle, la danse et la nature.
Mais quelles peurs s’expriment au cours de cette nuit ?
Il y a la peur des bruits amplifiés ou au contraire du silence, la peur du noir, la peur d’être seul·e, la peur de ne pas être retrouvé·e le matin par les organisateurs, la peur du froid, la peur de l’inconfort, la peur des serpents, des petites bestioles comme les tiques ou des sangliers, la peur d’un psychopathe. Certain·e·s ont plus peur avant la nuit que pendant. Dès lors, toute une gamme de comportements sert à éviter ces peurs : respirer profondément pour ne pas paniquer, ne pas enlever ses chaussures « au cas où », prendre un couteau ou un bâton avec soi, toucher les arbres pour se rassurer, chanter des comptines ou réciter de la poésie... L’abandon nocturne fait ressentir des émotions incontrôlables, qui sont le miroir du sauvage en nous.
Pourquoi vouloir révéler le sauvage qui est en nous ?
Cette expérience de contact avec le sauvage - c’est-à-dire une nature moins domestiquée - permet d’être dans le lâcher-prise par rapport au contrôle de nos émotions et de ne pas se couper du réel. C’est parce que l’humain s’est coupé de la nature qu’il la détruit. Dans l’histoire de l’humanité, l’homo sapiens s’est sédentarisé depuis 6000 ans, mais a vécu 294 000 ans en tant que sauvage parmi la nature. Cet héritage-là, il est enfoui en nous, sous des couches de civilisation. Révéler le sauvage qui est en nous, c’est savoir vivre avec l’autre, l’autre étant la nature, l’humain et le non-humain. L’accepter comme il est. C’est un rapport à l’altérité. C’est aussi accepter une nature non domestiquée, qui décide par elle-même. Le sauvage en nous, c’est donc aussi se libérer des normes, refuser le conformisme et les préjugés. C’est savoir résister et se rebeller.
(1) « François Terrasson, penseur radical de la nature », Génot J-C., Editions Hesse, 237 p., 2013.