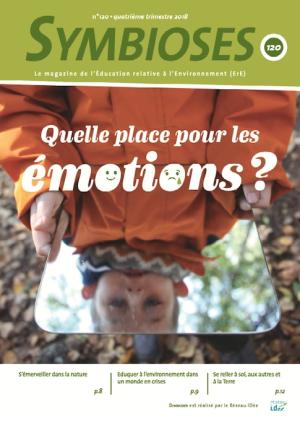L’accident nucléaire, comme si j’y étais
L’accident nucléaire, comme si j’y étais
4è trimestre 2018, un article de Christophe Dubois
Un article du magazine Symbioses n°120 : Quelle place pour les émotions ?
Pour lancer sa formation en urgence socio-humanitaire, le Centre d'Enseignement supérieur pour Adultes (CESA) simule un accident nucléaire. Durant 24h, les participant·e·s vont devoir agir quand tout est devenu hors norme. Séquence émotions.
« Attention ! Ce message d’alerte est retransmis par le Ministère de l’intérieur. Ceci n’est pas un test. Pour votre sécurité, veuillez respecter les instructions qui vont suivre : restez à l’intérieur, fermez portes et fenêtres, n’allez pas chercher les enfants à l’école, gardez votre calme ». Alors qu’ils visitent le Byrrrh Skatepark, à Bruxelles, une douzaine d’adultes entendent la radio interrompre son programme. Accident à la centrale nucléaire de Chooz, près de Givet. Pour leur premier jour de formation en urgence socio-humanitaire, c’est l’immersion. Jusqu’au lendemain 15h, ces adultes vont être confinés dans ce bâtiment industriel, dans la peau de victimes agissantes.
« Mais comment prévient-on nos enfants ? », s’inquiète l’un. « Mince, c’est près de chez moi », sourit l’autre, bien conscient d’être dans une fiction. Marie-Claire Peters et Valérie Wiels débarquent. Avec Laurent Van Eeckout, elles ont mis sur pied cette formation pour le Centre d'Enseignement supérieur pour Adultes (CESA, promotion sociale). Revêtues de combinaisons sanitaires intégrales, elles scannent les élèves : « Vous n’êtes pas contaminés, vous pouvez rester ici. On a amené du matériel pour calfeutrer les portes et fenêtres. Il faut aussi créer un sas pour scanner les personnes qui voudraient entrer, afin qu’elles ne contaminent pas le local ». Très vite, les unes et les autres se mettent en action, les tâches se répartissent.
Apprendre à (ré)agir
Caché à l’étage, Laurent joue le rôle de la protection civile. Il distille les infos au groupe, au compte goutte, via une application web défaillante. Au fil des heures, les problèmes impromptus vont se succéder. La Meuse est contaminée, il n’y a donc plus d’eau potable à Bruxelles. Plus d’électricité non plus. Le brouillard et le verglas ont mis le pays à l’arrêt. Puis d’autres victimes frappent à la porte (en réalité, des figurants bénévoles). « Peut-on les laisser entrer ? » Le groupe va devoir s’adapter aux événements. Et chacun·e devra s’adapter au groupe.
L’objectif de la formation est que tout·e citoyen·ne puisse intervenir, ici ou ailleurs, lors d’une catastrophe. « Ce n’est pas devenir un pro de l’urgence, cela ils peuvent l’approfondir durant un stage, mais apprendre à réagir adéquatement, rassembler les gens, tisser un réseau de solidarité, insiste Marie-Claire. A cela s’ajoute une part de développement personnel : découvrir son propre potentiel et ses limites, en ayant l’autre en miroir. C’est aussi questionner la mort, et comment je réagis face à cela. »
Les émotions au cœur des décisions
« Ici, ils basculent du statut d’intervenant à celui de victime. C’est tirer un fil sur des émotions parfois difficiles, explique Laurent Van Eeckout, qui a travaillé dans l’humanitaire en Haïti et ailleurs. Dans une situation d’urgence, avec la fatigue, comment je réagis, avec mes émotions et les quelques infos techniques - inspirées de la réalité - que je peux grappiller ? On ne parle pas d’effondrement, mais on le fait ressentir. L'accident technologique n'est qu'un exemple de scenario parmi d'autres. Notre objectif est d'observer le groupe en situation hors-norme, de façon à habituer les étudiant·e·s à un futur de moins en moins prédictible. »
Durant toute l’expérience, les participant·e·s sont filmé·e·s et consignent leurs émotions dans un carnet. Tout cela servira aux différents cours, dont celui de méthodologie relationnelle, dispensé par Valérie : « Ce vécu nous permettra de mieux comprendre les émotions, les détecter, examiner leur impact sur notre comportement, notre communication et nos décisions. Voir aussi à quel point l’environnement dans lequel on est plongé·e nous influence. »
Les experts du cerveau ne la contrediront pas. Pour Etienne Koechlin, directeur du Laboratoire de Neurosciences cognitives -Inserm (1) : « C’est très difficile de prendre des décisions si on n’a pas une expérience émotionnelle des conséquences de ces décisions. » Ça peut donc toujours servir…
(1) interrogé dans le documentaire « 2 degrés avant la fin du monde » - #DATAGUEULE, disponible sur Youtube.
Photos ©CESA